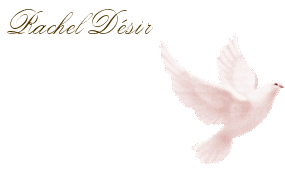1805 ... Trafalgar ...
Le vingt juin 1805.
Depuis l'aube, depuis les Antilles, je filais, sans hantise le train aux français, je voyais la poupe des espagnols, une nouvelle mer nacrée du sang de nouveaux bohémiens, je les suivais, je humais déjà l'odeur âcre de leur poudre. Poudre de canons, faiseuse de veuves aux lèvres pleureuses et demandeuses du dernier baiser, point de rêve dans l'abnégation au combat. Je sentais déjà la puanteur du rhum, la senteur ambre des gueules de bois, au sortir de leur bouche courtisane de pauvres marins de Napoléon. Et moi je pensais « point d'existence sans la mort joyeuse au fil de l'épée ou de la balle vomie d'un mousqueton «. J'étais vice amiral et commandeur de la flotte anglaise. J’étais Nelson et le trente- troisième cavalier des valeureux. Et devant moi a l'horizon, que j'estimais à cinquante mille marins, je regardais les lanternes des kiosques, arrières, là où les capitaines ripaillaient. Je les connais ces marins là. De bons marins mais pleutres à l'ouvrage, J'étais sur le Victory, armé de quatre-vingt canons. Et le vent filait sous les toiles, toutes les voiles étaient targuées au plus près, voile du temps, souillures d’âmes au vent.
Le vingt et un octobre 1805.
J'étais sur le pont supérieur, Je frottais mes bottes sur le pied d'un mât, elles devenaient luisantes, j’aurais aimé qu’elles deviennent sabre de bois. Je réveillais mes capitaines et mes marins, leurs yeux encore ensommeillés hurlaient malgré tout le chemin de Trafalgar. Mon amour le Victory, mon vaisseau fonçait ventre devant, vent devant et la mort en proue. Les Trois mats bruns tutoyaient l'Éole. Les trois ponts craquaient dur, les veinules de bois, gueules d’enfer vociféraient à entrailles ouvertes. Le souffle de l'air épuisait les voiles et trois faces couchées, tenancières d’un rien du tout. Debout, les mats, Debout les gars, Volez aux canons, prenez place sur les ponts, couchez vous devant la canonnade, mourrez devant l'ennemi. Puissance du feu, puissance d'un feu, la mort est rigolade, le paradis invraisemblable. Le feu tremble, des quatre- vingt canons. Je l'aimais mon navire, buste de Marianne à demi étouffé. Tout droit devant moi était le bucentaure, le navire amiral de la flotte française. Je devais le canonner pour que vive mon vaisseau, Alors, moi Nelson, Amiral de la flotte, je me confondais aux trois mats et aux trois ponts, comme une vie, de fait. Je m'étais habillé en grand apparat et sur ma chaire de bruit mais sans lumière, je voguais dans mon univers … Les voiles blanches, le phoque et le contre phoque voilaient le ciel bleu. J'étais Nelson, Vice amiral et lord de l'amirauté de la royale navy. Et les canons raisonnaient. Et la poudre suait, se mourait au creux de chairs d’êtres aimés et les canons tiraient, de vives voix, et les canonniers s'ébranlaient devant les bouches à feu. Elles crachaient des hombres de poussières noires, leurs gueules rougissaient du mal qu'elles faisaient. Le mat tombait, il se pliait... Les hommes mouraient, les hommes tombaient, des marins mouraient. Bon sang, des marins crevaient perfusés d’abîme. Alors je ne voulais plus tirer sur le Bucentaure, je devais le laisser debout pour que ses marins vivent. J'étais quand même le trente- troisième cavalier, je ne pouvais pas oublier qu'un marin doit aider un autre marin. Je stoppais net les tirs sur le Bucentaure, qui était pris en remorque par le Didon et tous deux allaient couler au large de Cadix. Mille morts. Et moi je mourais, tué par un mousquet, un dormeur de val au fond d’une rigole et rigole l’océan.
A découvrir aussi
- Le Sherman de 1994 et le quarante et unième chevalier de coeur.
- Creasy horse et, le 24 cavalier Inde, mort en en 1847.
- J'étais Ramsès 2.
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 18 autres membres